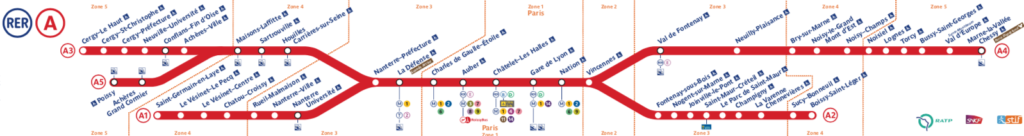Denis Breteau, 53 ans, est sans doute le dernier cheminot licencié de 2018, « radié des cadres » (l’équivalent du licenciement pour faute dans le secteur public), après 19 ans dans l’entreprise dont 14 au service des achats. Le 26 décembre 2018, l’ingénieur de e.SNCF, direction numérique logée à l’Epic de tête SNCF, recevait sa lettre de radiation signée de Benoit Tiers, directeur général de e.SNCF. Assortie d’une notification de sanction. Raison officielle du licenciement, « son refus répété d’accepter les postes proposés par sa hiérarchie, depuis sa mutation des achats vers e.SNCF ». En réalité, les relations étaient très tendues depuis 2010 entre l’ex-acheteur de la SNCF et sa hiérarchie, depuis qu’il avait alerté, puis dénoncé, ses supérieurs sur la manière dont étaient passés certains contrats informatiques.
« Denis Breteau avait quitté en avril 2016 la direction des achats contre laquelle il avait porté des accusations de harcèlement, pour être rattaché aux services informatiques (…) Responsable d’un projet de développement d’une application destinée à la gestion RH, il a bénéficié à l’occasion de cette affectation d’une promotion (…) Il a toujours refusé de s’impliquer dans ce processus de reclassement », indique la SNCF que nous avons interrogée. Denis Breteau, lui, a vécu les choses très différemment : « J’ai été nommé responsable d’une application de gestion des contrats d’intérim, « BAPS », abandonnée trois mois après mon arrivée. Je n’avais plus rien à faire, j’étais au placard, on brisait ma carrière ».
Renvoi d’ascenseur à IBM ?
A partir de juillet 2017, il n’avait plus aucune mission, à tel point qu’il restait chez lui. La direction l’oriente alors à l’Espace initiatives mobilité (EIM), cellule de reclassement interne. « Un Pôle Emploi interne à la SNCF, un mouroir !, selon Jean-René Delepine, du syndicat Sud Rail, membre du conseil d’administration de SNCF Réseau et défenseur de Denis Breteau. Il y a des milliers de cheminots à l’EIM, des pauvres hères qui ne sont plus employables ! », ajoute le syndicaliste. « Entre juillet 2017 et août 2018, quatre propositions de postes ont été faites à M. Breteau : deux sur Lyon, deux sur Paris avec des possibilités de télétravail (il habite Valence, NDLR). Il a refusé toutes ces propositions », indique un porte-parole de l’entreprise dans une réponse écrite à nos questions. « A Paris, on me proposait de m’occuper de la mise en cohérence de la politique RH, alors que je suis ingénieur informaticien. Quant aux deux postes à Lyon, ils étaient à la direction des achats, sous les ordres de ceux dont j’avais dénoncés les agissements dans l’affaire IBM, il y avait risque de harcèlement« , rétorque Denis Breteau. Ce que SNCF conteste.
L’affaire IBM ? Selon l’ancien acheteur, père de cinq enfants, il paierait le fait d’avoir dénoncé certaines passations de contrats ou des appels d’offres qu’il jugeait biaisés, car « saucissonnés », et dont aurait bénéficié le groupe informatique IBM. C’est à ce moment là que les ennuis commencent pour Denis Breteau. Une affaire complexe qui remonte à 2010, et pour laquelle la direction de la SNCF dément tout lien direct avec le licenciement de son agent. En résumé, la SNCF réfute toute volonté de représailles, et conteste les faits allégués.
Rappel des faits. En 2010, la SNCF avait créé une filiale, Stelsia, qui passait certains contrats de prestations informatiques de gré à gré avec IBM. La SNCF est pourtant soumise aux procédures de la commande publique qui l’oblige à organiser des appels d’offres, et interdit le « saucissonnage », qui consiste à ficeler des contrats d’un montant inférieur à 1,5 million d’euros, seuil au-delà duquel tout marché doit faire l’objet d’un appel d’offres. « Ces pratiques existaient, quant à Stelsia, il s’agissait d’une société écran pour détourner les règles européennes des marchés publics », indique Denis Breteau. « L’ensemble des marchés avec IBM, qui remontent à plus de dix ans, est en règle. Tant les contrôles indépendants, externe (mission de contrôle de Bercy dirigée à l’époque par Noël de Saint-Pulgent, NDLR) et interne, que la Commission des marchés de SNCF n’ont relevé aucune irrégularité », se défend la SNCF pour qui Stelsia était une « petite » filiale (558 M€ de chiffre d’affaires en 2016, source Infogreffe), dissoute en 2017 et « qui ne représentait qu’une part infime des achats de SNCF » (14 milliards d’euros, dont environ un milliard pour les produits et services informatiques, selon une source proche du dossier). Denis Breteau avait porté plainte contre X en 2012 devant le Parquet de Lyon pour infraction financière et pour harcèlement. Classement sans suite, les juges estiment que M. Breteau n’avait pas d’intérêt personnel à agir.
Sans suite, c’est aussi comme cela que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient demandé de classer un certain nombre d’appels d’offres informatiques, « pour ensuite passer des marchés de gré à gré avec IBM pour du matériel ou des services dont on n’avait pas forcément besoin ou que l’on payait deux à trois fois plus cher que celui qui aurait été obtenu par appel d’offres », assure le lanceur d’alerte. Un renvoi d’ascenseur suite à l’énorme marché logistique d’un milliard d’euros lancé par IBM et remporté en 2008 par Geodis ? C’est ce que confirment certaines sources syndicales, c’est la conviction de Denis Breteau.
Lanceur d’alerte ou pas ?
« Toute entreprise, même publique, prend quelques libertés pour les achats en urgence, mais dans le cas d’IBM, il s’agissait de malversations qui s’apparentent à de la corruption », estime t-il. J’ai alerté très tôt mes supérieurs hiérarchiques qui m’ont répondu que tout était légal. A mon sens, il s’agissait de malversations moralement inacceptables pour une entreprise publique, j’ai décidé de dénoncer ces pratiques », raconte le lanceur d’alerte. Un statut reconnu et protégé depuis la loi Sapin II de décembre 2016 qu’il ne se voit pas accordé par sa direction : « Denis Breteau n’est aucunement un lanceur d’alerte au sens de la loi (1) car il ne correspond pas à sa définition, et les faits dénoncés n’ont reçu à aucun moment le moindre commencement de preuve », indique la SNCF pour qui « il est indispensable de séparer clairement les deux sujets : l’instruction en cours du parquet financier (qui s’est saisi du dossier SNCF-IBM en 2017 NDLR)) et l’affaire Denis Breteau ».
Lanceur d’alerte ou pas, les salariés du secteur public ou privé peuvent pourtant dénoncer tout «fait de corruption» sans risquer de perdre leur poste, selon le Code du travail.
A l’époque, la seule à réagir, c’est la Commission européenne : saisie par Denis Breteau en 2015, elle met en demeure la SNCF de mettre fin fin aux activités de Stelsia , estimant qu »i s’agit « d’une construction artificielle (…) contraire au droit européen de la commande publique ». Sans appel ! SNCF considère « qu’il s’agit d’une divergence d’interprétation du droit des marchés publics : Stelsia, en tant que filiale (privée, NDLR), était-elle soumise ou non à la réglementation européenne ? Cette question juridique n’a jamais été résolue et la Commission européenne n’a pas ouvert de procédure contentieuse sur ce point », nous répond la SNCF. En effet, le recours de Bruxelles s’est éteint puisqu’en 2017, Florence Parly, alors directrice générale stratégies et finances de SNCF (aujourd’hui ministre des Armées) engage la dissolution de la filiale incriminée. Sommée par le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, de mettre de l’ordre dans les procédures d’achats, Florence Parly règle la question, mais le problème dénoncé par le lanceur d’alerte a bel et existé. Depuis 2017, tous les achats du groupe ferroviaire public sont revenus dans le giron de la direction des achats, mutualisée aux trois entités : SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
Echec de la rupture conventionnelle
Une autre zone d’ombre plane sur le différend qui oppose le lanceur d’alerte à son entreprise et lui a coûté son poste : une négociation en vue d’une rupture conventionnelle aurait été tentée en 2017 pour finalement échouer, les deux parties ne réussissant pas à se mettre d’accord sur le montant du chèque de départ. Interrogée, la SNCF n’a pas répondu à cette question précise. De son côté, Denis Breteau affirme que début 2017, cherchant à mettre fin à ce conflit interminable (changements d’affectation, refus de postes, mises à pieds), le DRH de e.SNCF, Stéphane Feriaut, lui aurait proposé un deal de départ : dix années de salaires. « La proposition était moralement acceptable : je ne perdais ni ne gagnait d’argent par rapport aux années qui me séparaient de l’âge de la retraite (j’avais alors 52 ans), on ne pouvait donc pas m’accuser d’avoir lancé l’alerte pour m’enrichir », analyse Denis Breteau. Des discussions en vue de ce départ négocié se seraient alors engagées avec Marie Savinas, DRH de l’Epic de tête SNCF. Elle aurait proposé 350 000 euros, D. Breteau aurait surenchéri à 450 000 euros, « la somme que j’aurais touché à la SNCF jusqu’à mon départ à la retraite », calcule-t-il. La DRH aurait jugé la demande « démesurée », et aurait finalement proposé 250 000 euros. Fin de la négociation, et un doute qui s’installe : Denis Breteau est-il un lanceur d’alerte désintéressé ? Ou a-t-il été piégé par sa direction ?
Il sera finalement licencié fin 2018 et a saisi début 2019 les Prud’hommes en référé, pour demander l’annulation de la sanction et sa réintégration à la SNCF. « A l’évidence, ce licenciement est l’aboutissement du harcèlement discriminatoire engagé contre lui, pour son rôle de lanceur d’alerte relative à des pratiques contraires aux règles de la commande publique », jugent Julien Troccaz, Eric Santinelli et Jean-René Delepine, représentants Sud Rail aux conseils de surveillance et d’administration des trois entités du groupe SNCF, dans un courrier adressé mi-janvier aux dirigeants, Frédéric Saint-Geours, Guillaume Pepy et Patrick Jeantet.
Le dossier des contrats IBM/SNCF est sur le bureau du Parquet national financier (PNF) qui s’est saisi de l’affaire en février 2017 et a ouvert une enquête préliminaire. « J’ai transmis les pièces apportant les preuves de mes allégations », expose le lanceur d’alerte qui a de nouveau été entendu début 2019, ainsi qu’un autre témoin, par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, suite à la parution d’un article de nos confrères du Parisien. Le bureau français de Transparency international s’intéresse aussi au dossier et Anticor a récemment envoyé un courrier au chef de la Mission de contrôle économique et financier des transports, rattachée à Bercy. Sans réponse, elle compte se constituer partie civile. L’affaire SNCF-IBM est loin d’être terminée. La lanceur d’alerte, lui, est au chômage.
Nathalie Arensonas
(1) la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, apporte une définition claire : «Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.