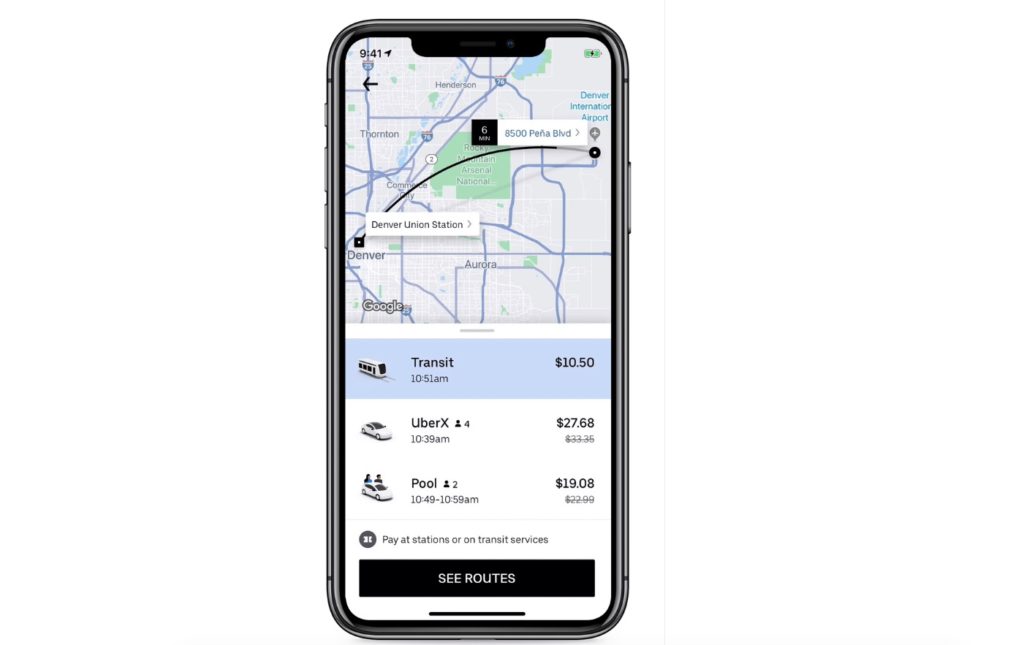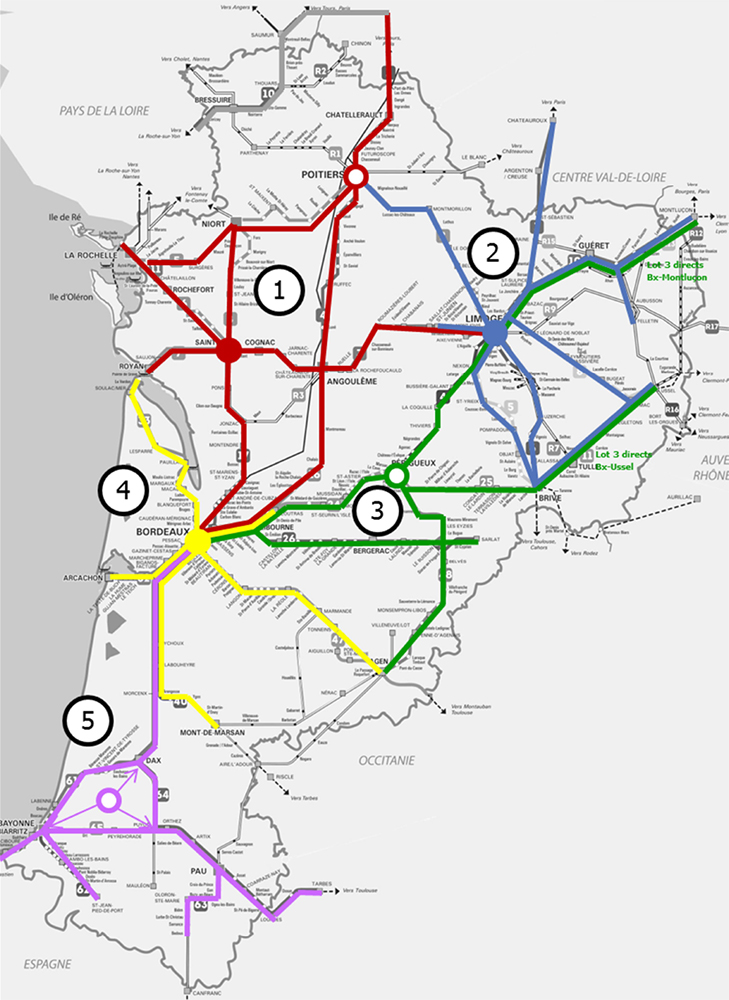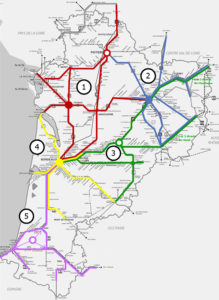Onze heures par jour (comme pour les taxis parisiens), 60 heures par semaine, voici les temps de conduite maximum des voitures de transport avec chauffeur (VTC) préconisés dans le rapport remis le 31 janvier 2019 au gouvernement, par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Ces mesures concerneraient Paris et 80 communes environnantes. Objectif, éviter les accidents et les effets sur la santé induits par des durées de travail excessives. Les données confidentielles des assurances sur les accidents de la route font ressortir une « probable » sursinistralité des chauffeurs de VTC, précisent les auteurs du rapport.
Ils recommandent aussi un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, quel que soit le jour de la semaine pour tous les chauffeurs VTC en France. Difficile d’en connaître le nombre puisqu’ils travaillent pour différentes plateformes numériques (Uber, Chauffeur privé, LeCab, etc.), mais dans l’exercice de transparence auquel s’est récemment livré Uber, on apprend que 28 000 conducteurs travaillent à partir de la plateforme du mastodonte du secteur. Pour mémoire, le 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a estimé qu’un plaignant était lié à Uber par un « contrat de travail », ouvrant la voie à une requalification en masse, une décision qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le temps de conduite est défini par le temps d’approche (temps pour aller chercher le client une fois la commande acceptée), la course avec le passager et le forfait (temps de repositionnement vers un stationnement). Comment comptabiliser le temps de travail des VTC, à 95 % des indépendants « embauchés » par ces plateformes numériques ? En « obligeant ces centrales de réservation à suivre le temps de conduite de chaque chauffeur et à adresser les données à un organisme totalisateur » et en lançant une étude pour la mise en place d’un contrôle électronique embarqué, préconise le rapport.
Tarif minimum des VTC ?
Selon leurs auteurs, il « n’est pas possible juridiquement d’instaurer un tarif minimum des VTC [une revendication des intéressés qui peuvent, au mieux, refuser la course s’ils contestent le tarif imposé, NDLR] ». Ils recommandent de lancer « un processus de concertation, sous l’égide de l’Etat, sur le prix décent de la prestation des chauffeurs » et proposent la création d’un fonds de soutien aux chauffeurs VTC en difficulté, qui serait financé par les centrales de réservation.
Un registre officiel de ces centrales pourrait être mis en place avec un « net relèvement des sanctions » en cas de non-respect de leurs obligations. Ils préconisent également que ces centrales soient soumises à un « régime d’autorisation préalable ».
En cas d’échec, le gouvernement pourrait imposer par la loi un tarif minimum, comme le fait la ville de New York. Les courses à Manhattan ont récemment augmenté de 2,50 dollars pour les taxis jaunes et de 2,75 dollars pour les VTC. Et les sociétés de VTC doivent en plus verser un salaire minimum à leurs chauffeurs.
Sur la base du rapport, « le gouvernement engagera une concertation sur toutes les questions relatives à la régulation du secteur », précise le communiqué des ministères du Travail et des Transports.
Le secteur des VTC a connu pas moins de trois lois en moins de dix ans (loi Novelli en 2009, loi Thévenoud en 2014, loi Grandguillaume en 2016) sans réussir à réguler l’irruption des plateformes numériques, comme dans d’autres secteurs de l’économie. La loi d’orientation des mobilités (LOM) qui sera devant le Sénat à partir de mars est chargée de transformer l’essai pour accompagner le développement du secteur et la régulation des plateformes (gestion, analyse, protection des données). Restera la question du temps de travail.
Nathalie Arensonas
1 617 euros par mois pour un chauffeur Uber
D’après les chiffres fournis par la plateforme fin janvier 2019, une fois la commission de 25 % d’Uber déduite du prix acquitté par le client, un chauffeur perçoit un revenu horaire brut médian de 24,81 euros. Il faut ensuite déduire les charges de location ou d’amortissement du véhicule, le carburant, les taxes, l’entretien et les charges sociales. Le revenu net horaire médian est de 9,15 euros de l’heure.
Sur l’hypothèse retenue par Uber d’un temps de connexion à l’application de 45,3 heures par semaine (temps de travail moyen des non-salariés) et 5,2 semaines de congés (moyenne constatée chez les non-salariés), le VTCiste aboutit à un revenu net mensuel de 1 617 euros. Uber n’a toutefois pas communiqué de chiffres moyens, correspondent-ils à celui des chauffeurs VTC qui travaillent en réalité plus longtemps, puisqu’ils sont souvent multiplateformes ?
N. A.