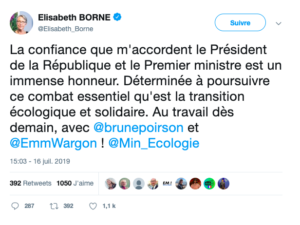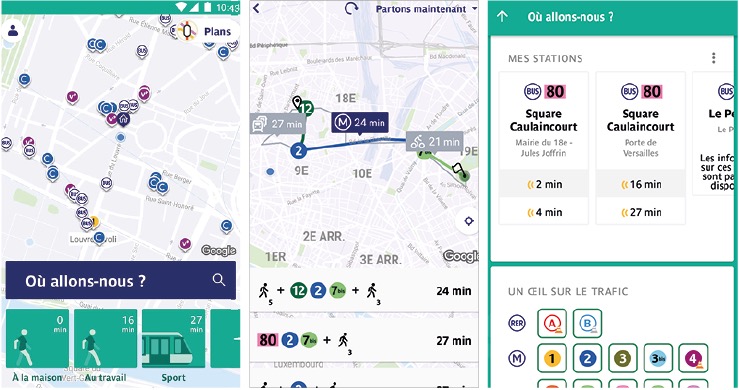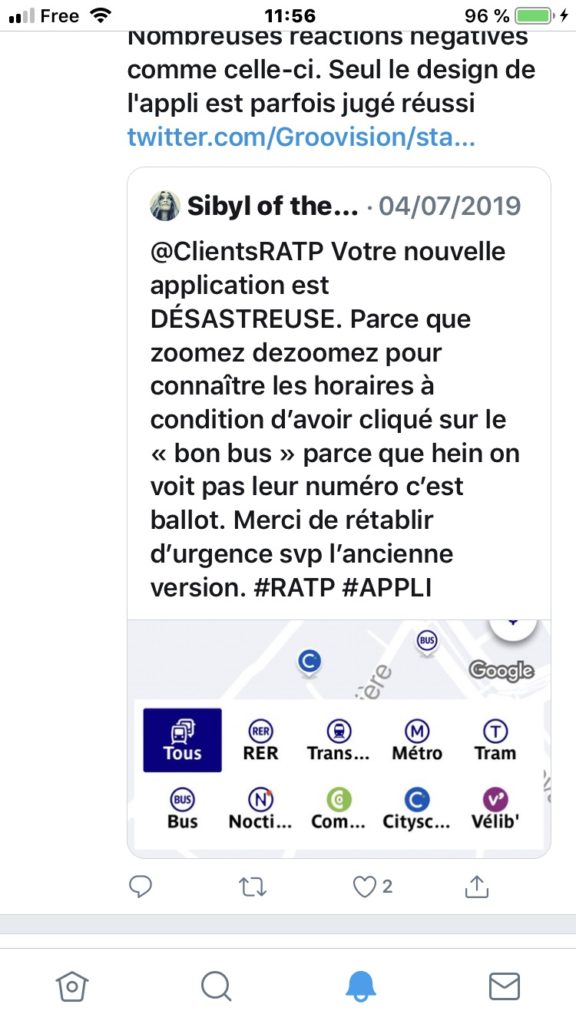Cela faisait deux ans qu’il en rêvait. Le 1er octobre 2019, les vœux de Bernard Roman, président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routiers (Arafer), seront enfin exaucés. L’ordonnance présentée fin juillet par la ministre Elisabeth Borne en conseil des ministres dans le cadre de la loi Pacte, confirme l’information dévoilée quelques semaines plus tôt par le patron de l’Arafer : après la régulation économique du transport ferroviaire, des autocars longue distance et le contrôle des concessions autoroutières, il ajoute une nouvelle corde à son arc avec les aéroports.
A l’automne prochain, l’Arafer qui deviendra alors l’ART (Autorité de régulation des transports), sera chargée de contrôler le niveau des redevances dont doivent s’acquitter les compagnies aériennes pour poser et faire décoller leurs avions, et avoir accès aux services aéroportuaires. Une compétence dévolue jusqu’à présent à l’Autorité de supervision indépendante, l’ASI qui était sous la tutelle du ministère des Transports, via le CGEDD (2). Elle disparait.
Lire aussi : « De la RATP aux aéroports, l’Arafer devient tout terrain«
Quel sera le rôle exact de la nouvelle autorité ? Comme pour les péages ferroviaires, elle sera chargée de valider chaque année le tarif des redevances aéroportuaires des exploitants d’aéroports accueillant plus de cinq millions de passagers par an. Elle formulera aussi un avis juridiquement contraignant, appelé « avis conforme », sur les projets de contrats de régulation économique qui fixent les conditions d’évolution des tarifs sur plusieurs années. Conclu en 2016 avec l’Etat, celui des Aéroports de Paris validé par l’ASI court jusqu’en 2020.
Doté d’un pouvoir de sanction, l’ART pourra saisir l’Autorité de la concurrence si elle constate des « pratiques prohibées » en matière de concurrence sur les aéroports relevant de sa compétence. L’ordonnance prévoit l’échange d’informations entre les deux autorités dans le secteur aéroportuaire.
Privatisation d’ADP
Pour faire face à cette nouvelle mission, le régulateur devrait voir son collège, l’organe décisionnel, renforcé avec davantage de membres permanents qui sont au nombre de trois aujourd’hui. Le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) demande une période de transition au cours de laquelle serait conservé le personnel de l’ASI (5 personnes sous la présidence de Marianne Leblanc-Laugier) au sein de l’ART afin de gérer notamment le dossier épineux de la double caisse de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. Ou celui du futur contrat de régulation économique d’ADP dont la privatisation était prévue dans la loi Pacte mais fait l’objet d’un référendum d’initiative partagée (RIP qui a recueilli à ce jour environ 550 000 signatures (3).
« Le SCARA sera très vigilant, lors de la discussion des futurs contrats de régulation économique, sur la transparence des règles d‘allocation des actifs (…) et veillera notamment à la définition précise des périmètres régulé et non régulé [recettes des commerces et des parkings] ; un paramètre fondamental dans la fixation du montant des redevances dues par les compagnies aériennes sur lequel l‘Autorité devra conserver le pouvoir d‘homologation. Si ce pouvoir d‘homologation revenait à l‘État, par l‘intermédiaire de la Direction générale de l‘aviation civile (DGAC), l‘indépendance de l‘Arafer serait fortement compromise« , prévient le syndicat professionnel.
N.A.