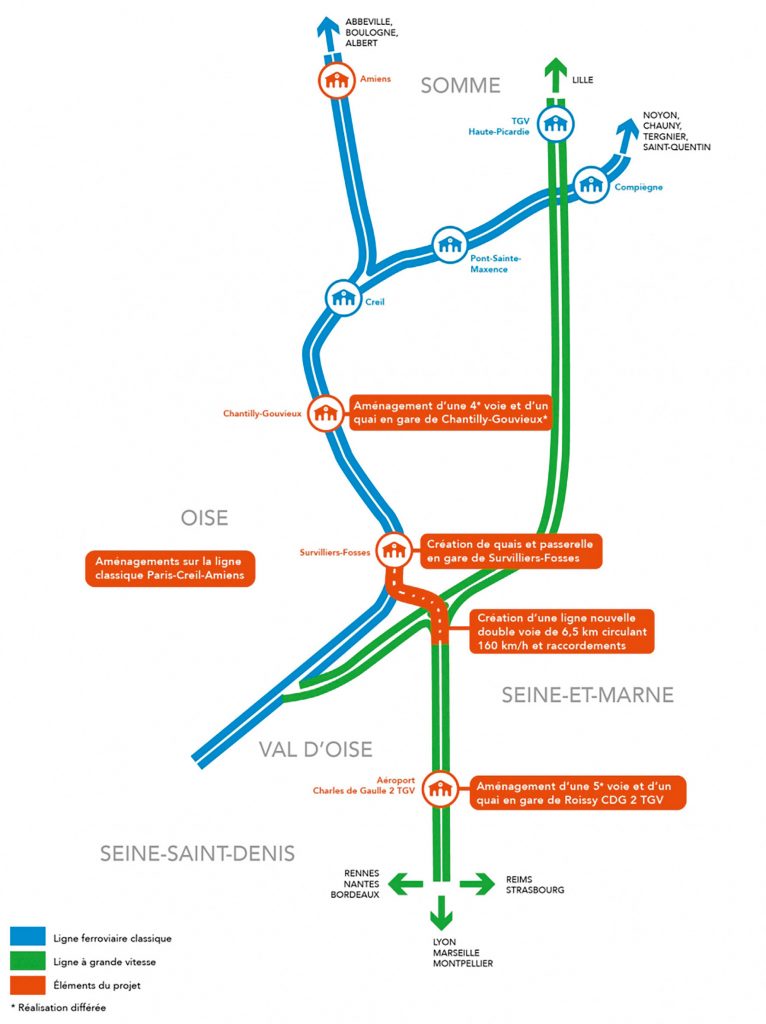Les ambitions étaient grandes, les attentes plus encore. Vingt ans tout juste après l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 en faveur des personnes handicapés, le bilan est décevant, notamment dans les transports. Le texte n’a pas permis d’améliorer notablement la mobilité des douze millions de Français en situation de handicap.
La volonté politique remonte pourtant bien avant 2005. Dès 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, une loi pour les personnes handicapées entend déjà favoriser leur transport. A la fin des années 90, le terme d’accessibilité est enfin évoqué, avant d’être institutionnalisé dans la loi de 2005, avec la promesse d’une plus grande mobilité pour les personnes affichant un handicap.
Principe d’accessibilité généralisée
La loi du 11 février 2005 s’engage à répondre à leurs attentes dans cinq grands domaines : la compensation, la scolarité, l’emploi, la création de maisons départementales et l’accessibilité. Cette dernière est considérée comme une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Aussi la loi prévoit-elle le principe d’accessibilité généralisée, quel que soit le handicap, physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif, polyhandicap.
Dans un délai de dix ans, elle doit permettre aux transports collectifs de devenir accessibles à tous. En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité d’un système de transport, les transports collectifs auront trois ans pour une mise à disposition de moyens de substitution accessibles au même tarif que les transports collectifs. Mais dès la promulgation du texte, des mesures doivent être prises pour faciliter l’accès au transport public : acquisition et renouvellement de matériels roulants accessibles, accompagnateurs, systèmes d’information, etc.
Ces obligations visent l’ensemble de la chaîne du déplacement : la personne handicapée doit pouvoir accéder à des locaux d’habitation neufs, privés ou publics, et dans certains cas, des locaux d’habitation existants lorsqu’ils sont l’objet de travaux. Elle doit aussi pouvoir être accueillie dans tous les bâtiments recevant du public et évoluer de manière continue, sans rupture (aménagement de voirie, accès aux gares, transports en commun). Une attestation de conformité est même demandée en fin de chantier par un tiers indépendant pour les travaux soumis à permis de construire.
Obligations de résultats
La loi fixe des obligations de résultats et de délais à respecter, en limitant les possibilités de dérogation. Elle prévoit aussi des sanctions en cas de non-respect de ces règles : fermeture de l’établissement ne respectant pas le délai de mise en accessibilité, remboursement des subventions publiques, amende de 45 000 euros pour les architectes, entrepreneurs et toute personne responsable de l’exécution des travaux. En cas de récidive, la peine est portée à 6 mois d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
La création d’une commission communale ou intercommunale d’accessibilité doit être constituée dans toutes les collectivités de plus de 5 000 habitants, permettant d’associer les personnes handicapées à la mise en œuvre de l’accessibilité. Les avancées se font attendre… Malgré une multiplication d’annonces. Sous la présidence Hollande, le gouvernement Valls met par exemple en place « des agendas d’accessibilité programmée », censés engager les gestionnaires de services de transport collectif à mener à bien des travaux de mise aux normes d’ici 2018 à 2024, selon les cas.
En 2017, lors du débat télévisé avant le second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron choisit d’accorder une large place au handicap. Il promet d’« accompagner les collectivités locales », sans enveloppe budgétaire précise.
Le 26 avril 2023, lors de la sixième conférence nationale du handicap CNH, le président prend de nouveaux engagements et promet de faire pleinement respecter les obligations d’accessibilité. Il déloque même une enveloppe de 1,5 milliard d’euros sur cinq ans. « Depuis cinq ans, nous avons fait de l’amélioration du quotidien des personnes handicapées l’une de nos priorités. Des évolutions sont d’ores et déjà visibles, mais de trop nombreux parcours sont encore freinés par des démarches longues et par un manque de solution. Le quinquennat qui vient sera le terrain d’un combat renforcé contre les injustices, par une démultiplication de nos moyens, de nos efforts, et des résultats », insiste le président Macron. Comme les précédentes, la conférence a rassemblé près de 800 participants qui ont fait de nombreuses propositions. Elles font l’objet d’un rapport remis au Parlement suivi d’un débat. La méthode a été applaudie par la majorité des associations de personnes handicapées.
En amont du Comité interministériel du handicap d’octobre 2022, pendant six mois, près de 500 personnes ont participé à des groupes de travail animés par les différents ministères : personnes en situation de handicap, élus locaux, entreprises, partenaires sociaux, opérateurs de transports, professionnels médico-sociaux, parlementaires et administrations. Organisée sur l’ensemble du territoire, la concertation a abouti à cinq grands chantiers nationaux. Aucun ne porte sur les transports. La mobilité n’est que le septième des dix engagements retenus. Il incite juste à « pleinement respecter les obligations d’accessibilité des établissements publics et des transports ».
Ce qui a le plus changé
* Les calculs d’itinéraires
« Les avancées sont réelles. Les personnes handicapées peuvent se déplacer plus facilement qu’avant 2005. Le chemin est encore long pour qu’il y ait moins d’entraves… ». Arrivé il y a cinq mois, Gaël Le Bourgeois, le délégué ministériel à l’accessibilité, se veut optimiste : il enregistre des retours positifs sur la qualité des aménagements et des services. « Des améliorations ont eu lieu dans les transports de surface et notamment les bus et les tramways. Dans le ferroviaire, 482 gares, dont les plus grandes, avaient été rendues accessibles à l’été 2024 grâce à des aménagements comme des ascenseurs ou des plans inclinés. Pour les malentendants, de l’information visuelle a été mise en place et pour les malvoyants, des informations sonores. Et des travaux sont en cours sur les gares secondaires », constate le délégué ministériel.
Il se satisfait aussi de la création en 2024 d’une plateforme unique pour réserver une assistance en gare. En 2023, 900000 prestations d’assistance avaient été assurées auprès de personnes à mobilité réduite. Une autre avancée majeure concerne la mise en place de tarifs spécifiques pour les accompagnateurs de personnes handicapées, mesure imposée dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités venue compléter celle de 2005. Elle réaffirme aussi le droit à l’information conformément à l’article L1111-4 du code des transports, qui prévoit que « l’usager soit informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation ». « L’accessibilité se pense de bout en bout. Le pire est de faire l’expérience d’une rupture dans la chaine de déplacement », reconnait Gaël Le Bourgeois.
Cela implique pour les autorités organisatrices ou les régions, l’obligation de prévoir des calculateurs d’itinéraires. « Elles doivent veiller à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial et à ce qu’il réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées », prévoit la loi.
Le développement de ces calculs d’itinéraires n’est pas sans poser de problème de collecte de données. Il est d’abord rendu compliqué par le recensement même des usagers handicapés utilisant les transports : 80% des handicaps sont invisibles et sur la majorité des réseaux, seules les personnes circulant en fauteuil roulant sont comptabilisées. Pour y remédier, le financement d’un outil de collecte de données nationales a été débloqué faisant suite à la publication d’un arrêté relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie. Les collectivités locales sont donc aujourd’hui dans l’obligation de collecter les données d’accessibilité des transports et de la voirie. Pour alimenter les applications permettant de renseigner les usagers sur les possibilités qui leur sont ouvertes, un standard national a été créé. Toutes les données doivent être conformes au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA).
« Notre rôle est d’animer tout un écosystème rassemblant AOT, transporteurs, filiales dédiées à l’information voyageurs, déjà pour les informer de leurs obligations, animer des groupes de travail, publier des guides, lancer des études et mettre en place des outils », explique Muriel Larrouy, chargée de mission au sein de la délégation ministérielle, en charge de l’accessibilité des transports, du stationnement et des données d’accessibilité sur les voiries et dans les transports. La spécialiste rappelle que des dizaines d’études ont déjà été menées. L’une d’entre elles, pilotée par l’Institut Gustave Eiffel, a permis de valider l’utilisation de scooters d’aide à la mobilité dans les tramways. Des groupes de travail se sont aussi réunis pendant deux ans pour assurer l’accessibilité dans les téléphériques urbains. « Comme ce type de projets part souvent de zéro, réunir tous les acteurs autour de la table, travailler ensemble à l’accessibilité urbaine qui va autour et penser à la globalité pour tous les handicaps est particulièrement pertinent », assure Muriel Larrouy.
* L’importance des données d’accessibilité
L’accessibilité a investi le champ des données numériques. L’information sur l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP comme les administrations, les restaurants…) est également soumise à un standard et une plateforme nationale collaborative : Acceslibre. Celle-ci permet de centraliser l’ensemble des données sur les ERP, données disponibles pour des particuliers, mais aussi pour des réutilisateurs qui peuvent ajouter cette information aux services fournis (City guide Sortiraparis.com qui affiche les informations sur l’accessibilité des lieux de sorties proposées recensés sur Acceslibre).
* L’usager, au centre de la qualité d’usage de l’accessibilité
Il est nécessaire d’assurer une qualité d’usage pour optimiser l’accessibilité. La notion de qualité d’usage d’un lieu peut se définir comme sa capacité à répondre aux besoins, attentes et contraintes des acteurs. Pour les bâtiments, il s’agit d’apporter des réponses spatiales, techniques et fonctionnelles qui permettent la prise en compte des occupants au sein d’un système complexe et tripartite qui constitue le bâtiment : acteurs, espaces et fonctions. Ainsi, la qualité d’usage s’appuie sur la prise en compte de l’usager dans le processus de conception et sur la démarche constructive du retour d’expérience.
Si dans le secteur des ERP, il existe déjà de nombreux labels et certifications. En revanche, le secteur des transports est moins diversifié, puisqu’il n’existe que deux démarches complémentaires :
C’est un outil pratique pour toutes les autorités organisatrices des mobilités et pour tous les réseaux qui souhaitent débuter une démarche qualitative complémentaire du volet investissement en matériel accessibles, en aménagements et en formation du personnel.
- Une certification, avec Cap’ Handéo Services de Mobilité, une entreprise certifiant des services de transport à la demande, de transport collectif et d’accompagnement individuel.
Plusieurs réseaux se sont engagés dans la démarche. Dans les transports collectifs, on peut citer la RATP pour une partie de ses lignes de métro et deux lignes de RER. Du coté des TPMR, plusieurs filiales du groupe Keolis ont la certification ainsi que des filiales du SynerGIHP ou encore de Transdev . Et du côté ferroviaire, la centrale de réservation Accès Plus Transilien a été certifiée en 2023 pour la qualité des services rendus.
* Une simplification des démarches dans le service ferroviaire
- La plateforme unique nationale de réservation des prestations d’assistance prévue par la LOM
L’article L1115-1 du code des transports introduits par l’article 28 de la LOM oblige le déploiement d’une plateforme unique de réservation de l’assistance en gare. Gares & Connexions est chargée de piloter le projet et de livrer le service en janvier 2024. Il est également prévu un point de contact unique dans chaque gare pour toutes les personnes qui en ont besoin. Un service d’autant plus important du fait de l’entrée de nouveaux opérateurs sur les réseaux français.
L’objectif est de simplifier la réservation de la prestation d’assistance en mettant en œuvre un seul centre de réservation, là où 16 centres de réservation existent aujourd’hui. Ce centre aura aussi la responsabilité de gérer en temps réel les aléas en proposant des solutions immédiates de substitution.
Il s’agira également pour tous les transporteurs, et surtout les distributeurs, de travailler avec la plateforme unique pour que le passage du distributeur au prestataire de plateforme unique soit le plus fluide possible.
Depuis mi 2022, les voyageurs disposent d’un module d’information qui renvoie systématiquement sur tous les numéros de plateformes et de centres de relation client en fonction du trajet (environ 20 % des clients font des trajets à correspondance). La mise en service de la plateforme est attendue pour janvier 2024 pour l’ensemble du réseau ferroviaire, et en 2025, la plateforme sera ouverte aux transports urbains et aux bus des villes qui le souhaiteront.