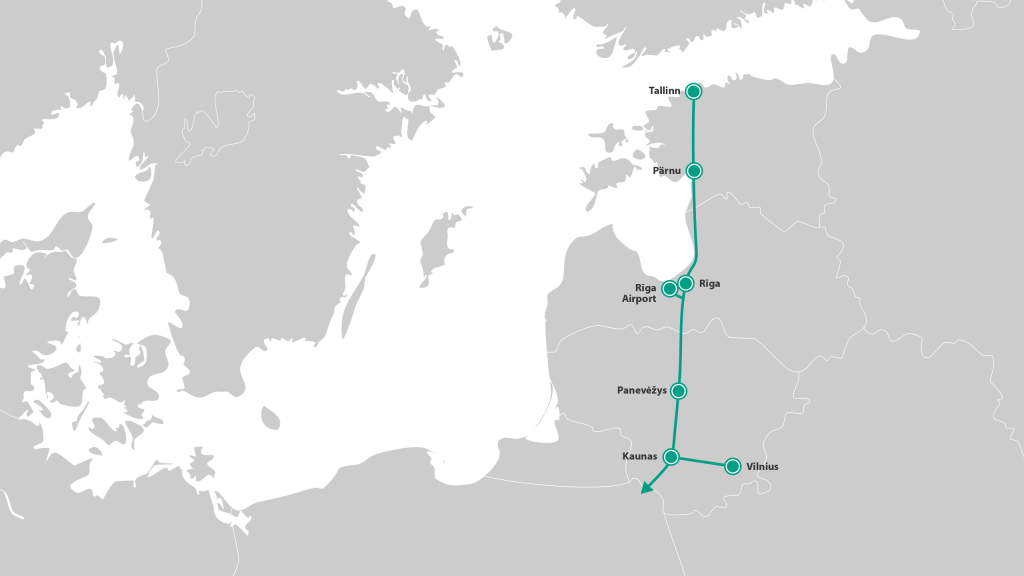Les trains de voyageurs transmanche assurés par Eurostar suscitent de longue date l’intérêt de nouveaux entrepreneurs mais leurs projets tardent à se réaliser. Après Evolyn, propriété de Britanniques et de Français, qui promettait un service en 2026, et Virgin qui annonçait encore récemment vouloir lever 800 millions d’euros pour concurrencer Eurostar, voici le nouveau venu Gemini Trains. Ses promoteurs ont annoncé le 24 mars vouloir lancer une compagnie ferroviaire pour exploiter des liaisons entre Londres et Paris d’une part, Londres et Bruxelles d’autre part. En espérant un démarrage pour la fin 2028.
L’équipe, présidée par Lord Tony Berkeley, un ingénieur ayant participé à la construction du Tunnel sous la Manche, « comprend des experts en commerce, finance, opérations, billetterie, et politique des transports, ainsi qu’une expertise de très haut niveau sur le marché ferroviaire français et européen », indique dans un communiqué la société Gemini qui est enregistrée en Grande-Bretagne.
« L’équipe travaille sur le projet depuis deux ans », explique Francis Nakache, ex-directeur général de Caf France, qui s’était reconverti dans le consulting et a rejoint l’aventure à l’été 2023 en tant que conseiller spécial. Des contacts ont été pris avec les régulateurs, les gestionnaires de gares et d’infrastructures, les gouvernements, les exploitants, tant côté français que britannique, souligne-t-il. Au Royaume-Uni, Gemini a déposé une demande auprès de l’Office of Rail and Road pour accéder au dépôt de maintenance international d’Eurostar à Temple Mills, qui est déjà fortement utilisé. C’est ce qui a incité les porteurs du projet à sortir du bois car cette requête peut être rendue publique.
La société Gemini envisage de lancer, dans un premier temps, entre trois et cinq fréquences sur la ligne Londres-Paris et sur Londres-Bruxelles. Avec « une approche novatrice en matière de vente et de billetterie » et des tarifs attractifs pour attirer une clientèle loisirs. Lesquels seront équilibrés avec une offre business. « Notre business plan a été challengé de façon très pointue », affirme encore Francis Nakache.
Reste à réaliser d’autres étapes essentielles, en particulier lever des fonds (le montant n’est pas dévoilé) et acheter des trains « de toute nouvelle génération ». Ce sera dans les prochains mois, affirme l’ex-dirigeant de Caf France.