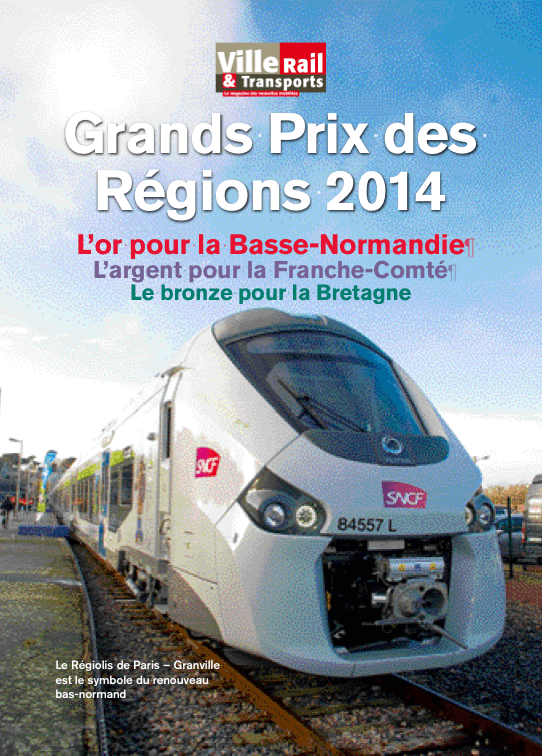La fin d’une époque ?
Lancé en 2000, pendant l’expérimentation qui allait faire des régions les autorités organisatrices des TER, notre palmarès des transports régionaux est le témoin de la mise en place d’un modèle évolutif. Mais ce modèle est-il durable, à l’heure des économies et de la remise en cause des régions actuelles ?
L’actualité des régions et de leurs transports est très riche. Avec sans doute des conséquences sur l’équilibre instauré depuis 2002, lorsque ces régions sont devenues autorités organisatrices des TER après quatre ans d’expérimentation. Depuis, un nouveau modèle de transport public a eu le temps de s’instaurer sur le réseau ferré français, ainsi qu’autour des gares, devenues pôles d’échanges multimodaux. Le tout dans le cadre de conventions entre les régions et la SNCF. Et côté infrastructure, gérée par RFF depuis le début de la régionalisation expérimentale, les régions prennent l’initiative de maintenir ou de rouvrir des dessertes voyageurs, quitte à en payer le prix.
La déclinaison des nouveaux services, plus adaptés aux besoins régionaux, l’amélioration de l’information, le développement de l’intermodalité et de tarifications simplifiant la vie des usagers des transports publics l’emportent sur la « balkanisation » que l’on aurait pu craindre a priori, les régions travaillant ensemble au sein de la commission transports de l’ARF. Y compris pour lancer, fin avril, l’Association d’étude sur le matériel roulant. Au-delà de l’aspiration des régions à être pleinement propriétaires des trains qu’elles paient, on peut voir la remise en cause d’un des rôles jusqu’à présent joués par la SNCF.
En mars déjà, la publication du Manifeste des régions pour le renouveau du système ferroviaire par l’ARF mettait les pieds dans le plat en demandant à la SNCF plus de transparence sur les conventions TER et une stabilisation des coûts à service constant. Dans le cadre de la réforme ferroviaire, les régions préfèrent voir les gares chez le futur gestionnaire d’infrastructure unifié que revenir à l’exploitant SNCF. Enfin, l’ARF demande la possibilité d’une ouverture à la concurrence d’ici 2019. Et son président Alain Rousset de menacer la SNCF, fin avril, de mettre en concurrence la maintenance des trains si son coût est trop élevé.
Pour des raisons plus financières qu’idéologiques, les régions doivent désormais limiter leurs charges d’exploitation. Ainsi que leurs investissements, ce qui rend incertaines les levées d’option sur les Régiolis et Regio 2N. Mais des solutions existent pour diminuer les coûts, telle la Régie régionale des transports Paca, qui exploite les Chemins de fer de Provence depuis janvier et pourrait peut-être reconnecter Digne au réseau ferré national sans passer par la SNCF ou RFF. Encore un exemple d’innovation induite par la régionalisation !
Mais voilà que l’on annonce un redécoupage des régions, alors que les élections sont prévues pour l’an prochain. A peine ont-elles eu le temps de développer des modèles inédits de transports de proximité que l’existence même les régions est remise en cause.
Alors, quitte ou double ?
Dossier réalisé par Patrick LAVAL
Un podium renouvelé et périphérique
Notre classement général récompense non seulement les meilleures performances en matière de transport régional de voyageurs en 2012, mais aussi les évolutions les plus remarquables entre 2011 et 2012. Le podium, entièrement renouvelé cette année par rapport à la précédente édition, récompense trois régions périphériques : deux littorales et une frontalière. Egalement primée dans la catégorie innovation, la Bretagne revient dans le peloton de tête après un an d’absence.
Grand prix d’or Basse-Normandie
Un parc jeune et des visions d’avenir
Après la Haute-Normandie, c’est au tour de la Basse-Normandie d’avoir les honneurs de notre podium. Les liens entre cette région et ses trains régionaux présentent une double nature : TER, dont la Basse-Normandie est autorité organisatrice et dont la convention avec la SNCF devra être renégociée en en 2015, mais aussi relations intercités avec Paris. Outre le grand axe électrifié Paris – Caen – Cherbourg, la région s’est battue pour la relation Paris – Granville, dont l’Etat est l’autorité organisatrice depuis le nouvel an 2011 (avec une convention d’exploitation SNCF jusqu’en 2030), mais dont la Basse-Normandie a financé à 100 % les 15 nouvelles rames Régiolis qui y seront mises en service cet été. Soit 148 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 20 millions d’euros pour leur nouveau site de maintenance. Le long de cette ligne, qui bénéficie d’une nouvelle jeunesse (avec, par exemple, mise en accessibilité en gare d’Argentan), il reste beaucoup reste à faire, en dépit d’une précédente modernisation intervenue il y a 15 ans déjà. A l’époque, la région avait été pionnière en mettant en service les autorails X 72500, alias X TER ; appelés à circuler sur des lignes TER, ces derniers sont maintenant remplacés sur Paris – Granville par du matériel plus récent, mieux adapté… et moins bruyant ! Son parc, le plus récent de France, explique en partie le premier rang de la Basse-Normandie au grand prix de cette année, avec un trafic en hausse (+46 % entre 2004 et 2012) et des performances honorables.
La Basse-Normandie, dont une rame a symbolisé la mise en service du Régiolis, le 29 avril dernier à Paris, a non seulement un TER jeune, mais aussi un plan d’action, dit « Rail 2020 », par lequel elle intervient également dans la modernisation de l’axe Caen – Rennes ou les études de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Parallèlement, la région s’intéresse à l’articulation entre la desserte par les transports publics et l’urbanisation à long terme, en particulier autour des gares (contrats de gare, projet d’écoquartier à proximité de la gare d’Audrieu, entre Caen et Bayeux).
Grand prix d’argent Franche-Comté
Plus près de la Suisse
Cette région, dont l’axe principal est doublé depuis fin 2011 par la LGV Rhin-Rhône, a redéveloppé ses dessertes TER pendant la période dont nous étudions l’évolution, ce qui s’est traduit par la deuxième meilleure progression de l’offre. En revanche, la Franche-Comté est loin d’avoir le parc le plus récent de France. Un léger rajeunissement est toutefois intervenu avec l’acquisition de 4 autorails X 73500 d’occasion dans le cadre de conventions signées avec l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais. Et pour 2013-2017, une nouvelle convention a été signée avec la SNCF.
Depuis décembre 2012, l’offre s’est enrichie de deux relations expérimentales vers la Suisse au départ de Pontarlier, vers Travers et Vallorbe, respectivement exploitées par les CFF et la SNCF. Ces deux relations matinales, qui permettent aux frontaliers de gagner des zones d’emploi dynamiques et des correspondances avec le réseau ferré suisse, bénéficient d’un conventionnement spécifique et d’un financement réparti entre la Franche-Comté (22 %) et le Canton de Neuchâtel (78 %) pour la première et entre Franche-Comté (2/3) et le Canton de Vaud (1/3) pour la seconde. Au passage, la desserte Pontarlier – Vallorbe marque un arrêt de plus depuis décembre 2013 dans la gare de Labergement-Sainte-Marie, rouverte après près de 40 ans de fermeture. Pour pérenniser ces services transfrontaliers, fréquentés par près d’une centaine de voyageurs par jour, la région a des échanges avec les associations de travailleurs frontaliers et certains employeurs suisses pour encourager le report modal et offrir une tarification spécifique avec un titre commercialisable via Internet également proposé en version mensuelle et annuelle.
Grand prix de bronze Bretagne
Innovation et qualité de service
Année après année, la Bretagne ne cesse de présenter les meilleurs taux de régularité et de réalisation de l’offre. Et son parc, déjà largement renouvelé, est appelé à rajeunir encore avec 17 rames Regio2N. L’arrivée de ces rames aura lieu d’ici celle de la LGV, en 2017, au terme d’une période qui vient de faire l’objet d’un prolongement de quatre ans de la convention TER 2007-2013.
Côté innovation, la Bretagne poursuit des projets de longue haleine. Le comptage des voyageurs a été mis en œuvre en 2013, initiative saluée cette année par notre Grand Prix de l’Innovation. Pionnière de la billettique multimodale (KorriGo), elle a mis en place à la rentrée 2013 une formule simple et économique (8 ou 15 euros selon la distance) pour les trajets occasionnels effectués en TER par les moins de 26 ans. Depuis mi-2013, en complément des investissements engagés pour rendre son réseau TER accessible en 2015, la Bretagne expérimente, avec la SNCF et des associations, le service d’assistance Accès TER destiné aux PMR. Enfin, la Bretagne, en partenariat avec le Morbihan et la communauté de communes du Pays de Guer, a inauguré un premier point d’arrêt routier « qualitatif et multimodal » au lieu-dit Val Coric, sur la ligne Rennes – Pontivy, le long d’une deux fois deux voies. Un point comprenant parking, arrêt de car aux normes PMR, taxi, wi-fi et toilettes sèches, voire ultérieurement parc à vélos et borne de recharge pour véhicules électriques.
Patrick Laval
Les Grands Prix thématiques
Huit catégories font l’objet de prix thématiques cette année. Pour chacunes d'elles, nous avons demandé aux régions de présenter leurs réalisations des années 2012-2013, avant d’inviter les membres de notre panel d’experts (consultants, représentants d’usagers, du Gart et de l’ARF ainsi que la rédaction de Ville, Rail & Transports) à choisir les réalisations les plus dignes d’être mises en valeur. Les résultats ont été très serrés dans les catégories « gare intermodale », « services voyageurs », « mobilité durable » et « communication ».
Innovation Bre
Le dossier complet est réservé aux abonnés
ou aux détenteurs d’un porte-monnaie
électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !
 Les Grands Prix des Régions 2014
Les Grands Prix des Régions 2014