Qualité de l’air. Le métro pas épargné par la pollution
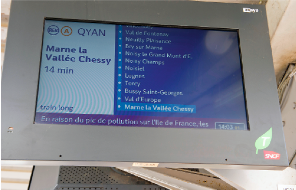
Lors des différents pics de pollution, les pouvoirs publics avaient incité les Franciliens à prendre les transports en commun. Mais les utilisateurs du métro n’échappent pas à toute pollution : ils risquent d’inhaler les particules fines dues au système de freinage des rames.
L’air intérieur du métro est vicié par les polluants provenant de l’extérieur, mais aussi par la pollution générée par la circulation des trains. Parmi les polluants extérieurs, on compte notamment le dioxyde de soufre ou les hydrocarbures. Sophie Mazoué, chargée de la qualité de l’air dans les transports à la RATP, explique qu’ils ne sont pas constamment mesurés « soit parce qu’il y en a très peu dans nos enceintes, voire pas du tout, soit parce qu’il n’y a pas de source interne et des concentrations très faibles et donc peu de raison de les suivre en continu, alors qu’un suivi ponctuel est suffisant pour surveiller les niveaux ». Mais l’air intérieur est constitué également de polluant émis par les activités de la RATP. Il s’agit notamment de particules fines.
En termes de qualité de l’air intérieur, l’Union européenne n’a pas fixé de seuil limite, mais une valeur cible de 25 microgrammes de PM10 par mètre cube à respecter avant le 1er janvier 2015. « La RATP a vraiment accentué ses efforts sur la surveillance de ces particules. Les mesures montrent que les niveaux de particules sont supérieurs à ceux de l’environnement extérieur avec une composition différente. On a des particules qui proviennent de phénomènes d’usure et donc, forcément, les particules sont plus grosses, pénétrant moins profondément dans les voies respiratoires que dans l’environnement extérieur, où ce sont des phénomènes de combustion qui produisent les particules très fines », explique-t-elle.
Selon une étude d’Airparif menée en 2011 sur le quai du RER Magenta, les particules fines sont composées à 87 % de carbone élémentaire, qui pénètrent dans les organes. Plus leur taille est petite, plus elles interagissent avec l’organisme. Le contact entre le train et les rails génère des frictions d’où sont issues les particules. Plus le train est chargé, pire seront les émissions. Toutefois, pour Sophie Mazoué, il n’y a pas de raison de s’inquiéter de leur effet sur la santé. La RATP a mené plusieurs études pour vérifier l’impact sanitaire des particules sur ses agents. Une étude de toxicité a été engagée avec le professeur Aubier à l’hôpital Bichat sur les salariés passant 8 heures dans les souterrains. Les résultats, publiés en 2007, n’ont montré « ni de prévalence supérieure de symptôme respiratoire et cardiovasculaire pour l’étude épidémiologique ni de surmortalité pour l’étude de mortalité », assure-t-elle. « Les usagers qui passent, peut-être une heure le matin, une heure le soir, ont une exposition réduite par rapport au personnel de l’entreprise. »
De plus, les particules PM10 sont mesurées quotidiennement par le réseau Squales (Surveillance de la qualité de l’air et de l’environnement) de la RATP, implanté dans trois stations : Châtelet, Franklin-Roosevelt et Auber. Les PM2,5 à l’inverse ne rentrent pas dans les mesures quotidiennes du réseau. Et depuis 2008, la RATP publie les résultats de ses mesures sur son site Internet. Sophie Mazoué explique à propos des relevés qu’ « on a des valeurs quel que soit le paramètre, qui sont plus élevées en période d’exploitation. La nuit vous allez retrouver des seuils vraiment bas puisque les sources de pollution (air extérieur, exploitation, voyageurs) sont moins importantes. » A titre d’exemple, sur la ligne 4 à Châtelet, le 10 juin 2014 entre 11 et 12 heures, on comptait 216 microgrammes de PM10 par mètre cube d’air. Au même endroit, entre 5 et 6 heures du matin, on n’en comptait plus que 19 microgrammes. Cependant, la RATP relativise : selon Sophie Mazoué, qui cite une étude de l’UITP, les réseaux de Buenos Aires et de Londres seraient bien plus pollués que le métro parisien.
Pas une raison pour ne rien faire : plusieurs actions sont envisagées pour lutter contre les émissions de particules fines. Par exemple, le freinage électrique qui permet de « réduire le freinage mécanique, donc les frictions et par conséquent les particules », poursuit la responsable de la qualité de l’air à la RATP. En combinant plusieurs actions, les baisses seront significatives. Ainsi, sur la ligne 1 où l’ajout de ventilateurs a permis, selon la régie, de « réduire de 65 % le taux de particules ». Depuis 2004, l’exploitant a amorcé un programme de création et de renforcement de la ventilation, qui doit s’achever en 2016. Entre-temps, les résultats de l’étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sur les conséquences sanitaires de l’exposition des agents à cette pollution souterraine, apporteront peut-être d’autres questions. Ils doivent être publiés en fin d’année.
Chloé NIEUWJAER
Les agents en première ligne
Travaillant au quotidien au contact des particules, les agents du métro sont les premiers concernés. « On ne ressent pas cette pollution au quotidien. Est-ce que ça a un impact tout de suite sur la santé ? On ne le pense pas. Mais des effets à long terme, on le craint de plus en plus, expose Sylvain Eslan, délégué syndical central adjoint de la CFDT. La santé c’est une préoccupation majeure. On voudrait qu’elle soit au premier plan pour la RATP. » Si le syndicaliste salue le système Squales mis en place par l’opérateur, il en souligne les limites : on assiste à « une banalisation des relevés » sans aboutir à de véritables actions. De plus, « sur des lignes comme le RER A, on a de l’ancien matériel et du nouveau et pas de tableau comparatif sur les systèmes de freinage notamment. Le CHSCT a donc lancé une étude sur le sujet. »
Cette banalisation des relevés est d’autant plus critiquable qu’elle semble exonérer la RATP d’une communication efficace auprès de ses salariés : « elle communique sur son site mais pas directement auprès de ses salariés », poursuit Sylvain Eslan. Il prend l’exemple du freinage électrique censé atténuer les émissions de particules fines. « Cette action est intéressante en termes de développement durable. Le but est d’économiser de l’énergie. Mais sur les émissions de particules, on n’a aucun moyen de savoir aujourd’hui si c’est fiable ou pas. » Un manque de transparence qui l’amène à craindre « qu’il n’y ait pas eu d’évolution significative des émissions de particules fines ». Il demande un suivi régulier des effets de « toutes les actions menées pour lutter contre l’empoussièrement ».
Il appelle également les pouvoirs publics à se saisir de la question en se penchant sur la différence entre « les mesures environnementales qui fixent un seuil pour les particules à 50 μg/m3 en moyenne journalière, et le seuil professionnel issu du code du travail à 5000 μg/m3 sur huit heures. On a l’impression que les salariés qui travaillent huit heures sont totalement oubliés ». Ch. N.
Publié le 07/03/2025 - Marie-Hélène Poingt
Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal
Publié le 05/02/2025 - Sylvie Andreau, Nathalie Arensonas


































