 Quand le Grand Paris fera surface
Quand le Grand Paris fera surface

Les tunneliers sont à l’œuvre et le métro avance. Mais comment vont s’organiser les mobilités dans les villes concernées ? L’un des partisans du nouveau métro, Pascal Auzannet, s’est fait aussi l’historien du projet. Dans une réédition largement complétée de son livre, Les secrets du Grand Paris, il imagine un acte II du Grand Paris Express. Dans lequel un algorithme d’intérêt général, intégrant les nouveaux moyens de mobilité, permettrait de proposer des systèmes complets de transport. Un système relevant du MaaS mais ne dépendant pas des Gafa.
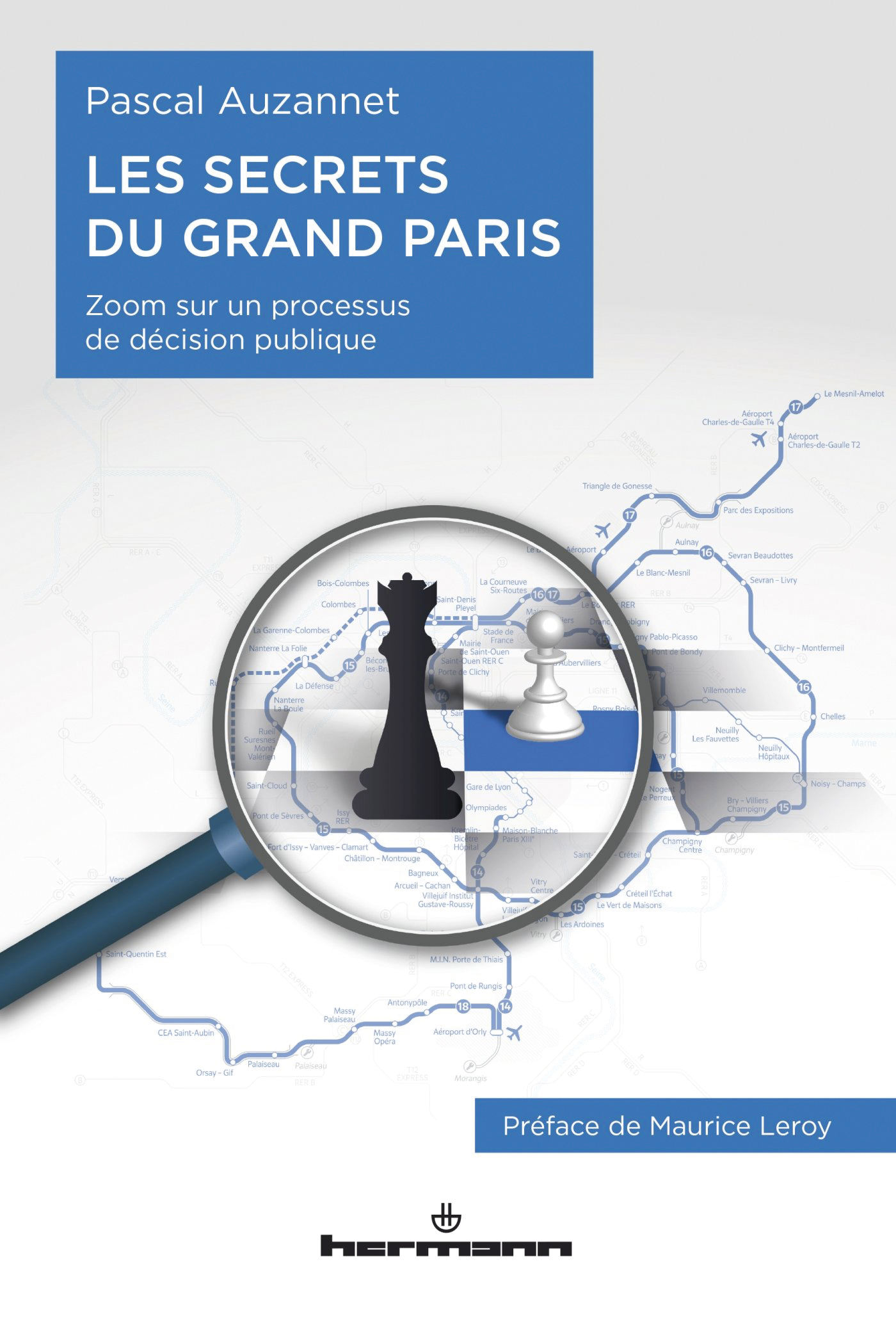
On croyait l’année faite de quatre saisons. Pascal Auzannet a publié en 2018 une histoire du Grand Paris Express qui n’en comptait que trois. On attendait donc la suite. La voici dans une nouvelle édition de son livre (Les Secrets du Grand Paris, éditions Hermann). Mais, plutôt que de s’en tenir à une quatrième et dernière saison, Auzannet en a ajouté deux. Surnuméraire, la cinquième n’a rien de superflu.
Une fois fait un sort à la suite de l’histoire du métro, de 2013 à aujourd’hui, ce qui est tout de même le cœur du propos, l’auteur, qui était jusqu’en mai dernier PDG de RATP Smart Systems (il vient d’être remercié), a additionné deux de ses compétences, la connaissance très fine et très ancienne du Grand Paris, et celle plus fraîche des nouvelles technologies, pour avancer une nouvelle proposition : ajouter au plus vite un volet concernant l’espace urbain tout autour du futur métro.
Avec un outil. « Je propose, nous dit Pascal Auzannet, une plate-forme numérique de type MaaS. » Mais, on s’en doute de la part d’un ancien membre du cabinet de Jean-Claude Gayssot, un MaaS différent de celui que proposent les Gafa. Ou de celui que projette Dara Khosrowshahi, le PDG d’Uber, qui a l’ambition de « devenir l’Amazon du transport ». L’idée, au contraire, c’est « un MaaS fondé sur un algorithme d’intérêt général. »
Un MaaS qui pourrait d’ailleurs être mis en œuvre un peu partout. En France s’éloigne-t-on pour autant du Grand Paris ? Pas vraiment. Avec une quinzaine de tunneliers à l’œuvre, le métro a cessé d’être un grand projet pour s’imposer comme réalisation majeure. Elle va poser de nouvelles questions très vite. Avec 200 km de nouveau métros on double le réseau parisien. Bien, mais qu’en est-il de l’utilisation du réseau ferroviaire qui complète le dispositif ? Comment faire pour irriguer les villes desservies par les 68 stations projetées ?

Auzannet souligne : « On a besoin d’autres mobilités, indépendantes et complémentaires du Grand Paris ». Les deux tiers des déplacements dans la région font moins de trois km : autant dire qu’aux alentours des gares ils vont être impactés par le nouveau métro et qu’il est temps de concevoir de vrais systèmes complets de transport. Mieux encore, de « bien traiter l’espace ».
Certes, la question n’est pas nouvelle. Mais, tandis que, puits après puits on assemblait les tunneliers et qu’ils se mettaient à forer, une petite révolution se produisait en surface qui change la façon de la poser. De nouveaux véhicules sont arrivés et, avec eux, de nouveaux usages : vélos en libre-service, vélos en free floating, trottinettes, scooters, covoiturage, VTC, gyroroues, etc. Véhicules dont Auzannet souligne l’importance, conforté par une étude de l’Apur, l’Agence parisienne d’urbanisme, publiée en mai 2020, Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos en partage (voir ci-dessous). Un jour, peut-être, pourra-t-on se passer largement des services du véhicule personnel. Consommer moins d’espace. Sur ce plan, la voiture électrique, si elle reste personnelle, ne sera pas d’un grand secours. Voici donc l’automobile, avec un taux d’occupation en milieu urbain de 1,1 personne, une utilisation en moyenne seulement 5 % du temps, squeezée d’un côté par le métro, de l’autre par le vélo ou les modes émergents.
Le métro ? « Il faudrait une infrastructure routière de plus de 100 à 150 m de large pour remplacer la ligne 14 si elle n’existait pas », rappelle Auzannet. Et, à l’autre bout, on fait passer quatre à cinq fois plus de monde à vélo au mètre linéaire qu’en auto, avec une vitesse de 15 km/h pour le vélo, identique ou légèrement supérieure selon les estimations à celle de la voitu
L'article complet ( 2400 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !
Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal
Publié le 05/02/2025 - Sylvie Andreau, Nathalie Arensonas
Publié le 10/01/2025 - Philippe-Enrico Attal


































