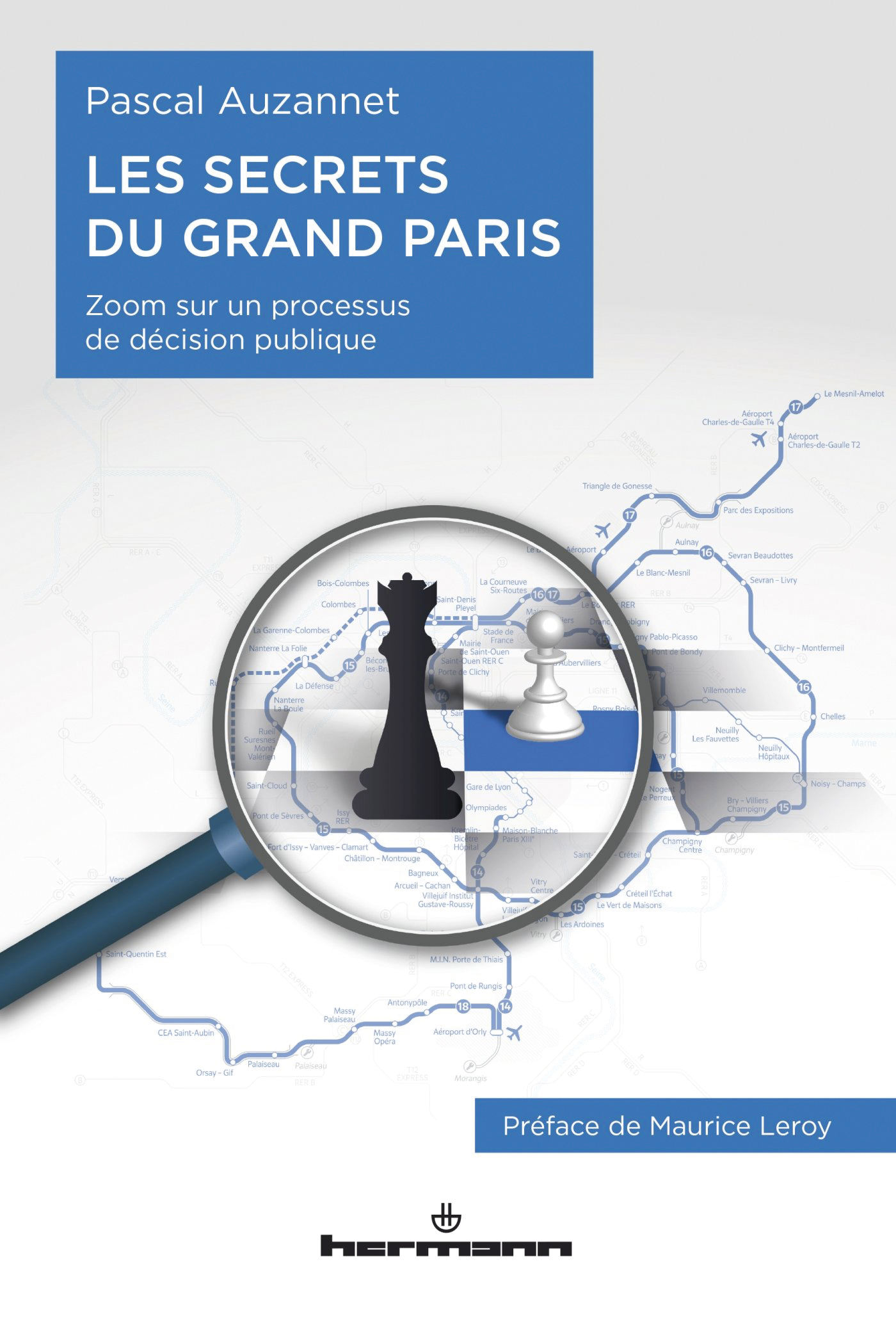Après « Les secrets du Grand Paris », Pascal Auzannet publie « Le casse-tête des mobilités en Ile-de-France ». L’ancien président de RATP Smart System, qui a travaillé sur la configuration du Grand Paris après avoir été notamment le directeur des RER à la RATP, nous donne des clés pour mieux comprendre le patchwork institutionnel en Ile-de-France. Et propose, à quelques mois des élections municipales, ses solutions pour le rendre plus efficace. Interview.
VRT. Pourquoi ce nouveau livre?
Pascal Auzannet. J’ai un peu d’expérience après mes fonctions passées au sein de la RATP, de ses filiales et de l’Etat. Je me suis intéressé à de nombreux travaux réalisés en économie des transports ainsi qu’aux rapports de la Cour des Comptes qui à défaut d’être suivis constitue une source d’informations. Et maintenant que j’ai une parole complètement libre, je trouve important de livrer un état des lieux sur les mobilités franciliennes et d’esquisser des pistes d’actions opérationnelles. A la veille des élections municipales, il y a une opportunité : il faut lancer le débat pour permettre aux politiques de s’approprier des options.
Après mon livre (Les secrets du Grand Paris), qui s’intéressait aux coulisses, aux prises de décisions politiques, je traite de tous les modes et mets en lumière à chaque fois le rôle des instances. Je décris le patchwork institutionnel où évoluent de nombreux acteurs, l’Etat, la RATP, la SNCF, la région, IDFM, la métropole… Il y a de belles réussites mais chacun reste dans son couloir et il y a un manque de synergies. C’est coûteux pour la collectivité. J’ai pu ainsi identifier d’importantes marges de progrès.
VRT. Par exemple?
P. A. Prenons l’exemple de la vitesse commerciale des bus qui s’est dégradée de 2000 à aujourd’hui : elle est passée de 13,3 km/ h à 9 km/h à Paris et de 18,3 km/h à 13,2 km /h en banlieue. Ce qui représente un gaspillage financier de 400 millions d’euros par an. Or, les différents acteurs ont du mal à s’organiser entre eux : l’Etat a la tutelle sur la RATP et celle-ci contractualise avec IDFM. L’entreprise travaille aussi en lien avec les gestionnaires de la voirie. Les centres de décision sont ainsi dispersées, il y a donc un manque de pilotage.
Je propose de confier ce rôle à la métropole qui n’a pas la compétence mobilité en Ile-de-France. C’est une exception en France. La métropole n’a pas non plus la compétence voirie. Pourquoi ne serait-elle pas une autorité organisatrice de second rang pour les bus, les trams, autrement dit les transports de surface? Cette idée, à débattre, permettrait de rentrer dans le droit commun. La métropole, sous réserve de financements nouveaux pourrait aussi récupérer la voirie. Sans doute faut-il avancer par étapes comme je l’explique dans le livre.
J’ai identifié d’autres pistes, comme par exemple les navettes fluviales, un sujet qui ne mobilise pas IDFM. Pourquoi ne pas les confier également à la métropole? De même elle pourrait organiser les mobilités dans un rayon de 2 à 3 km autour des gares où il n’y a pas de véritable pilote. La métropole pourrait apporter une expertise en ingénierie pour la réalisation de sites propres par exemple et travailler à un plan métropolitain bus.
VRT. Quelles sont les autres pistes d’amélioration possibles?
P. A. Le rythme d’automatisation des métros me paraît beaucoup trop lent. Une douzaine d’années s’est passée entre l’automatisation de la ligne 1 et de la ligne 4. On parle de 3035 pour automatiser la 13. Il y a un gros risque d’avoir demain un métro à deux vitesses, avec d’un côté le métro du Grand Paris, et de l’autre le réseau historique.
VRT. Pourtant, la Fnaut Ile-de-France se dit déçue par l’automatisation de la ligne 4. Et elle estime que les progrès apportés par l’automatisation de la ligne 13, dont les performances ont déjà été nettement améliorées, seront finalement faibles comparée à son coût…
P. A. Les estimations montrent sa pertinence car le taux de rentabilité de l’automatisation de la ligne 13 est élevé : il atteint 16,1 %. Cet intérêt socio-économique est transposable aux autres lignes. Mais la RATP traîne des pieds alors qu’il n’y a pas de problème social. Il est tout à fait possible de reclasser les conducteurs vers des postes à responsabilité.
VRT. Quelles sont les principales suggestions que vous faites aux candidats aux municipales en Ile-de-France?
P. A. Je ne comprends pas pourquoi IDFM ne permet pas l’open paiement, qui consiste à faire payer les trajets avec une carte bancaire. Une centaine d’agglomérations y seront passés en 2026-2027 selon le Cerema et selon un rapport présenté lors de la conférence de financement. C’est déjà en service à Londres, Bruxelles et d’autres capitales dans le monde. C’est un mode de paiement de nature à faciliter la vie des voyageurs occasionnels et cela permettrait de mieux lutter contre la fraude dite « molle ». Rappelons que la fraude représente un manque à gagner de 700 millions d’euros annuels pour les transports publics.
J’aborde aussi le sujet de l’optimisation de l’existant, qui passe par une meilleure productivité, notamment des conducteurs qui pourraient rouler plus en gagnant plus. Pour y parvenir, il faut que l’Etat reste à sa place : il a vocation à intervenir sur les questions de stratégie mais pas sur la gestion quotidienne. La tutelle de la RATP par l’Etat est ainsi devenue un non sens.
Selon moi, c’est à la région de reprendre cette tutelle. En tant qu’ancien directeur des RER, je peux affirmer que par un bon management, on peut améliorer l’efficacité sans en passer toujours par une hausse des investissements. Evidemment certains sont indispensables (matériel roulant, régénération des infrastructures). Il faut laisser aux entreprises le soin de négocier. Or, l’Etat ne veut surtout pas de grève et ne peut s’empêcher d’intervenir. Il y a aussi la productivité du capital à améliorer.
VRT. L’ouverture à la concurrence peut-elle favoriser cette hausse de la productivité que vous appelez de vos voeux?
P. A. Rappelons d’abord un fait : ce n’est pas l’Europe qui a décidé la mise en concurrence des réseaux. Le règlement de 2007 reconnaît la possibilité aux autorités organisatrices d’attribuer la gestion de ses transports directement à une entité. IDFM n’était donc pas obligée de mettre en concurrence la RATP. Mais la RATP a voulu se développer en France et à l’international via RATP Dev. Bruxelles lui a donc demandé de choisir : soit vous restez chez vous, soit vous allez au delà de l’Île-de-France mais vous acceptez que des concurrents viennent chez vous. C’est le second choix qui a été fait. Pour IDFM, c’était aussi un moyen de prendre la main sur la RATP.
Aujourd’hui, RATP Dev s’est développée mais est déficitaire. De son côté, avec la concurrence, la RATP a perdu 35 % de son réseau bus historique même s’il faudra attendre l’attribution des deux derniers lots pour dresser un bilan complet. Sur le Grand Paris Express, la RATP, avec l’option de la Régie, aurait pu légitimement revendiquer les 200 km de lignes de métro nouvelles. Or, elle a perdu les lignes 16, 17 et 18 et n’a gagné que la 15 Sud. Finalement, selon moi, la RATP a plus perdu que gagné dans cette affaire. Elle est en train de complètement perdre son identité. Avant c’était une entreprise parfois certes un peu insolente, mais créative. Le baromètre interne le montre : seulement 34 % des salariés ont un avis positif sur les orientations stratégiques. Ils ne s’y retrouvent plus.
Alors aujourd’hui, on en tire les conséquences ou on continue avec le ferroviaire ? Je défends l’idée d’une régie ou SPL pour le ferroviaire (métro, RER, train) qui serait sous l’autorité de la région et d’IDFM. C’est d’ailleurs une tendance forte à l’échelle de notre pays où la population desservie par des transports urbains par un opérateur interne est passée de 11,6 % à 27,5 % entre 2005 et 2025.